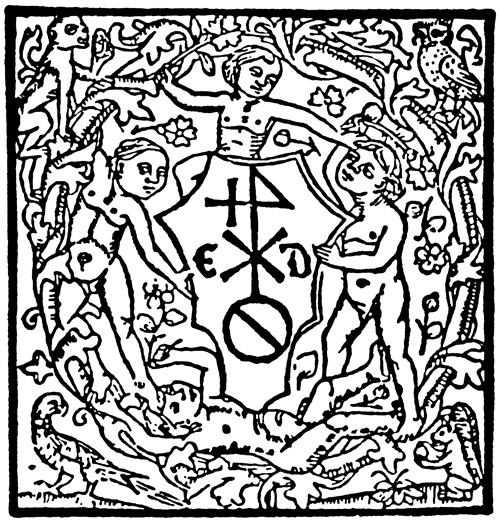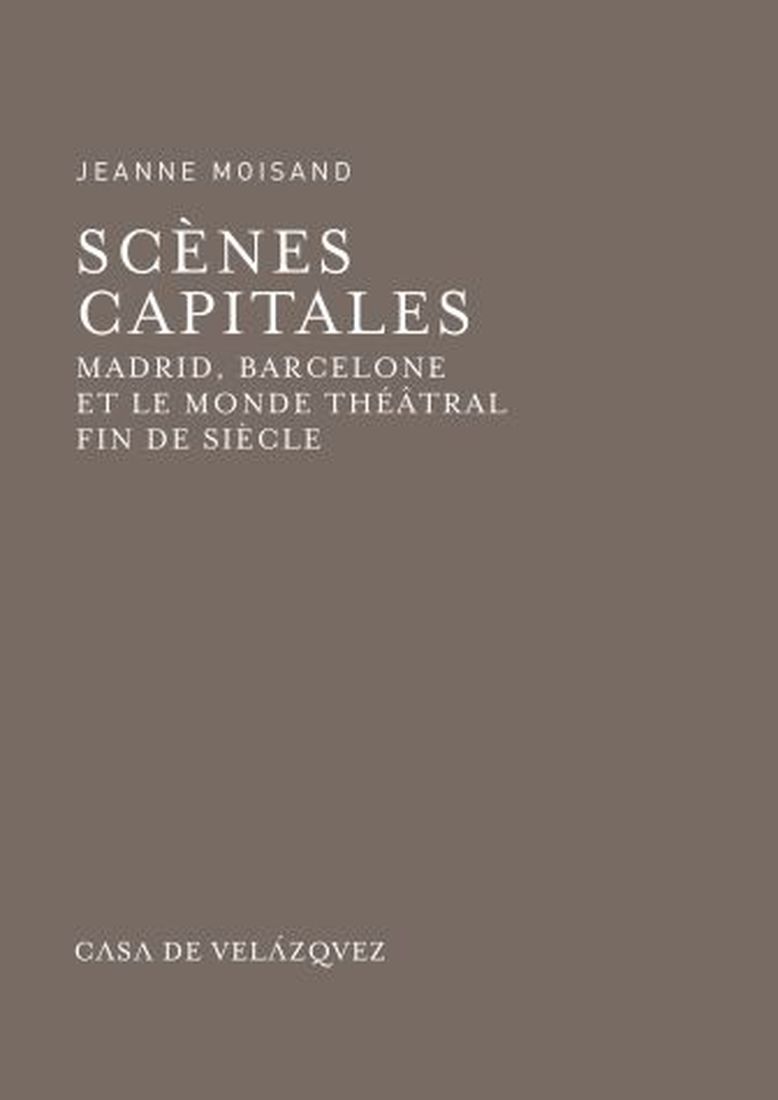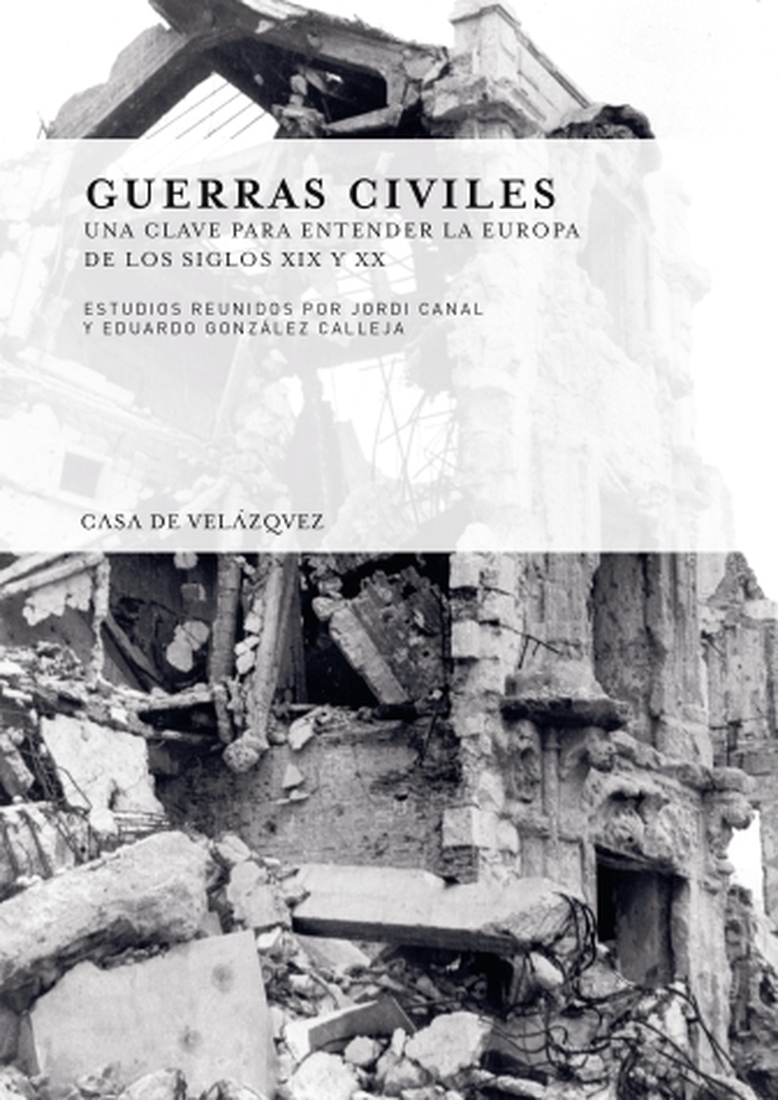XIXe siècle
Emile Zola, employé de bureau, chroniqueur, romancier besogneux... un autodidacte acharné ? En reprenant la notion d’autodidaxie dans son sens originel et en la replaçant dans son histoire au XIXe siècle, cet essai revisite le cliché littéraire qui pèse sur Zola. La décrire suppose de reconsidérer les racines culturelles d’une autoformation hors du commun, entre 1858 et 1868. A partir de 1869, avec le lancement des Rougon-Macquart, son activité d’écrivain ne met pas un terme à son apprentissage, mais témoigne plutôt d’une autodidaxie experte qui dépasse la formation initiale tout en conservant la logique exploratoire des formes artistiques. Sur l’étendue de sa carrière, l’artiste sculpte son œuvre selon un dépassement de soi, en lien avec le champ littéraire de son temps. Le montrer à partir de la genèse des grands cycles zoliens, mise en relation avec sa correspondance littéraire et le baromètre de la réception, suppose de concevoir une génétique culturelle des processus de création.
Dans cet essai Olivier Lumbroso s’interroge sur la naissance de l’écrivain et se demande comment on le demeure grâce à des médiations qui, en dehors de l’Ecole, offrent à l’artiste les « écoles » de sa « formation permanente », dont les avant-textes sont l’un des laboratoires. Il en ressort, chez Zola, une posture de résistance contre son propre talent et un défi d’autodéveloppement, qui dépasse le métier et la doctrine naturaliste, afin de redonner de la puissance au roman et à la vie.
La longue vie du marquis de Bombelles, né en 1744 sous le règne de Louis XV, s’achève au début de l’année 1822. Son Journal, tenu quotidiennement de 1780 à sa mort, est la chronique de ce presque demi-siècle.
Le huitième et dernier tome de ce journal, qui couvre les années 1815 à 1822, aurait dû être le temps de la sérénité : la patrie retrouvée, la monarchie restaurée, la famille rassemblée. Il a surtout été le temps du désenchantement ; le marquis n’a pas reconnu, en 1815, le pays qu’il avait quitté en 1789 ; la cour de Versailles ne s’est pas reconstituée ; le roi lui-même n’est plus que l’ombre du souverain imaginé par le marquis. Sans doute Bombelles nous livre une vision nostalgique de ces années, mais aussi un récit vivant et fidèle du temps.
Le corps à l’œuvre étudie la réception, très débattue, du moulage sur nature. Les empreintes de Geoffroy-Dechaume que les expositions récentes ont révélées au public, La Femme piquée par un serpent de Clésinger, qui émut en son temps, mais passe inaperçue des visiteurs du Musée d’Orsay aujourd’hui, la Pythie de Marcello toujours visible à son emplacement d’origine à l’Opéra, L’Age d’airain et le Balzac de Rodin, dont on admire toujours les exemplaires en bronze, enfin, La Danseuse de Falguière, dont on a perdu la trace, sont autant d’œuvres qui nourrissent la réflexion sur le naturalisme de la sculpture , au XIXe siècle, et sur le statut du modèle. Au cœur du problème se trouve l’imaginaire du corps tel qu’il hante la pensée de l’art. Pour le saisir, Jean-François Corpataux multiplie les points de vue : anthropologie, histoire de la réception, psychologie du sujet, analyse formelle, connaissance des techniques sont tour à tour convoquées. Un thème néanmoins domine : le jeu entre animation et pétrification. L’auteur, rendant hommage aux études antérieures les plus stimulantes, a cherché à en développer les implications de façon originale, et à donner une image d’ensemble nuancée des mécanismes matériels, intellectuels et psychiques qui gouvernent la création et la réception de la sculpture dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Dans la continuité de ses travaux sur la polémique (Polémique en tous genres, Cahiers du CADGES, n) 7), le Groupe d’Analyse de la Dynamique des Genres et des Styles (XVIe-XVIIIe siècles) propose ici une nouvelle approche centrée cette fois sur la constitution, l’holution et le statut des querelles littéraires, dans leurs rapports avec les formes génériques, qui peuvent être le lieu d’épanouissement, mais aussi l’enjeu des querelles, Celles-ci portent parfois sur des genres en quête de reconnaissance ou en cours d’évolution, Ainsi la « querelle d’Alceste»), à la fin du XVIIe siècle, ne vise-t-elle rien moins que le statut littéraire de l’opéra, et en arrière-plan, mais de manière essentielle, la nature de la tragédie, tout comme deux cents ans plus tard, le conflit politique et religieux qui oppose Ronsard aux protestants se double d’un débat littéraire qui modifie significativement son écriture et la conception même qu’il se fait de la poésie. Aborder les querelles par les genres dont elles se nourrissent et qu’elles façonnent est bien une question qu’affrontent toutes les communications ici rassemblées : comment le contexte éditorial, le public, le déroulement chronologique de la querelle, induisent-il le recours à tel ou tel genre littéraire? Certaines, quand l’objet s’y prête, vont cependant plus loin et permettent de formuler l’hypothèse que les querelles littéraires pourraient elles-mémes se constituer comme genre ou comme institution. C’est sans doute sur ce point que la réflexion est particulièrement féconde, A quelles conditions une querelle littéraire peut-elle en effet se statufier en genre littéraire? Objet vivant et insaisissable, que l’on identifie comme tel alors qu’il est déjà largement répandu dans la République des Lettres, les querelles ne risquent-t-elle pas alors, en s’accommodant d’un corpus génériquement stable, de mettre en péril leur existence même ? Car la querelle est par définition frondeuse, ou si l’on préfère polèmique, non seulement dans son objet mais dans son existence méme, surtout lorsqu’elle est elle-méme une imposture, comme chez Jean de Boyssiéres. Le traitement des genres littéraires dans une querelle peut tantôt les bousculer, tantôt les renforcer. On le verra ici largement à travers des querelles célèbres ou moins célèbres, qui toutes, même si certaines d’entre elles restituent, en filigrane, d’autres enjeux, en particuliers politiques, nous plongent au coeur même de l’institution et de la vie littéraires.
LES MUSÉES DU PROTESTANTISME
Marianne CARBONNIER-BURKARD et Patrick CABANEL, « Introduction » ;
De la spiritualité et de la mémoire au musée
Olivier ABEL, « Spiritualités et musées » ;
Patrick CABANEL, « Les protestants français et le ‘‘désir de musée’’ » ;
Daniel TRAVIER, « Les Cévennes, lieux de mémoire, XIXe-XXe siècles » ;
D’un musée l’autre
Gabrielle CADIER-REY, « Les musées du protestantisme en France » ;
Alain BOYER, « Les musées du protestantisme en France: aspects juridiques » ;
Marianne CARBONNIER-BURKARD, « Le Musée du Désert: un centenaire » ;
Benjamin FINDINIER, « Le Musée Jean Calvin de Noyon » ;
À Genève et dans les pays du Refuge
Isabelle GRAESSLÉ, « Le Musée international de la Réforme ou le patrimoine immatériel revisité » ;
Susanne LACHENICHT, « Musées huguenots et lieux de mémoire en Allemagne et dans les Îles britanniques » ;
Bertrand VAN RUYMBEKE, « Lieux de mémoire et musées huguenots aux États-Unis et en Afrique du Sud » ;
Conclusion
Philippe JOUTARD, « Identité huguenote, mémoire et histoire, une articulation de longue durée ».
Le 15 mars 1841, la Revue des deux mondes publie, sous la rubrique « Poètes et romanciers modernes de la France » un long article intitulé « M. Rodolphe Töpffer » sous la signature prestigieuse du grand critique Sainte-Beuve. Pour l’auteur genevois, presque inconnu hors de sa ville natale, c’est la consécration venue de Paris de son talent original.
Dans le courant de cette année 1841, la publication par le libraire parisien Gervais Charpentier, sous les auspices de Xavier de Maistre, des Nouvelles genevoises fera connaître au public français les écrits de Töpffer. Celui-ci renoue de son côté des relations amicales avec son cousin Jacques-Julien Dubochet, qui publie à Paris des éditions illustrées d’auteurs classiques; les grandes lettres qu’ils échangent sont à l’origine de la parution des célèbres Voyages en zigzag, publiés d’abord en 1843 en livraisons hebdomadaires puis en 1844 en un très beau volume illustré d’après les dessins de l’auteur.
Rodolphe Töpffer continue sa collaboration à la Bibliothèque universelle de Genève, met au net le manuscrit du récit du Voyage de 1840 accompli en automne de cette année, et effectue durant les vacances d’été de 1841 son périple le plus long qui le conduira avec ses pensionnaires jusqu’à Venise.
A Genève, les circonstances politiques se modifient peu à peu sous l’influence de « radicaux » menés par James Fazy qui souhaitent des changements dans un sens libéral. Les « vingt-cinq années de bonheur » écoulées depuis la Restauration de 1814 sous un régime aristocratique vont se terminer lors des incidents qui se produiront à l’Hôtel de ville le 22 novembre 1841. Rodolphe Töpffer prendra alors avec des amis la défense des « conservateurs ».
Après le volume sur 1816. Genèse de la Foi publique relatif aux années 1816-1848 où l’on voyait la naissance et l’affirmation d’un nouveau système politico-financier, l’intérêt se porte ici sur la tumultueuse seconde moitié du XIXe siècle. En France, le système financier traverse de profonds bouleversements politiques - la Révolution de 1848, la Guerre franco-prussienne de 1870-71 qui entraîne la chute du Second Empire et inspire les événements de la Commune, une crise financière (1882), une crise politique affectant la IIIe République (1892-1893), ainsi qu’une crise bancaire en 1914 - sans toutefois en être véritablement ébranlé. Il s’agit d’analyser les voies et moyens institutionnels, réglementaires, financiers, mais aussi politiques, idéologiques et culturels destinés à prévenir les crises et à assurer la pérennité de la Foi publique, clé de voûte de la confiance des épargnants dans le système des caisses d’épargne, adossé depuis 1837 à la Caisse des dépôts. La confrontation avec d’autres systèmes financiers européens (la Belgique et l’Italie), dotés d’institutions, d’acteurs et de pratiques différents, offre l’occasion de mesurer les écarts dans les comportements et de mieux comprendre la gestion des crises. Manière de confirmer que l’histoire financière bien comprise ne saurait ignorer ni les modes de construction politiques et institutionnels des États-nations ni les pratiques sociales et économiques des détenteurs de capitaux, petits et grands.